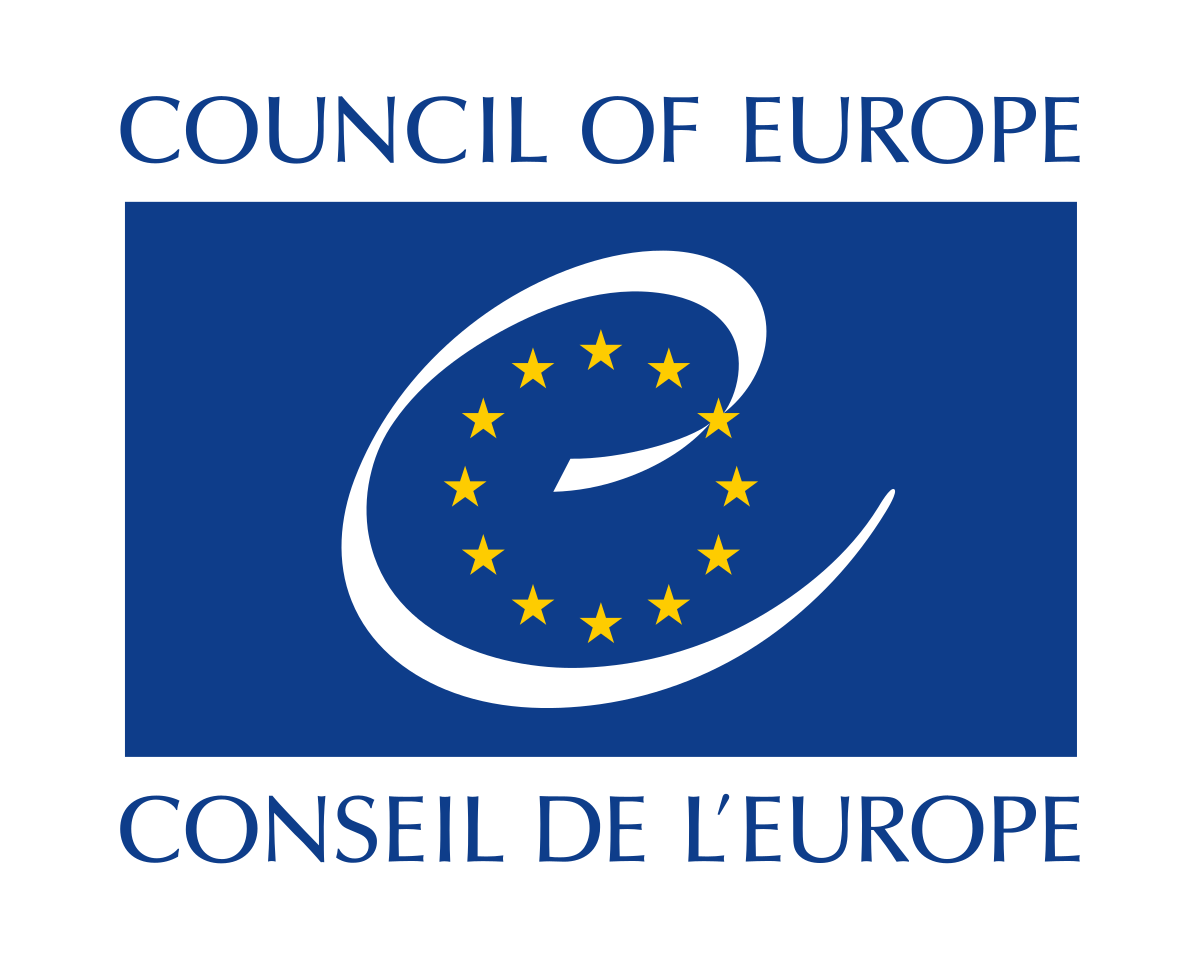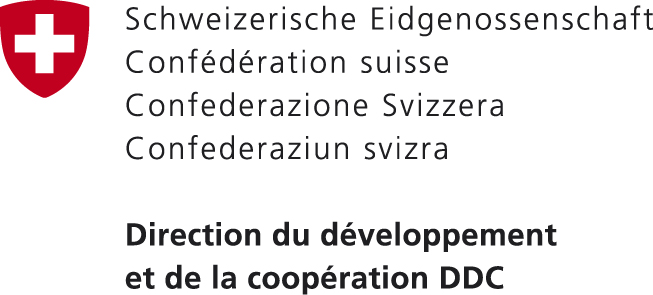A Casablanca, la Caritas offre un havre aux migrantes

Présente également à Rabat et à Tanger, la Caritas a repris à Casablanca un accueil de jour réservé aux migrantes subsahariennes et à leurs enfants. Alors que le passage vers l’Europe est toujours plus difficile, des salariés et des bénévoles essaient de les aider à imaginer un autre avenir.
 Le Service accueil migrantes de Casablanca. Les femmes et les enfants y trouvent soins,
Le Service accueil migrantes de Casablanca. Les femmes et les enfants y trouvent soins,
cours et conseils pour envisager une solution d’avenir, 2014.
Il est près de 16 heures et les enfants vont bientôt s’ébrouer dans la petite cour du « SAM », le Service accueil migrantes (1). Tout à côté, malgré le bruit et la promiscuité des locaux, leurs mères achèvent leurs cours d’anglais, de français ou de couture, ou tentent de réunir, avec l’assistante sociale, les pièces de leur dossier de régularisation. Chaque jour, dans ce service de la Caritas, hébergé par la paroisse Saint-François de Casablanca, les « habituées » côtoient les nouvelles venues. Venues du Cameroun, de Centrafrique, de Côte d’Ivoire ou de Guinée-Conakry, toutes partagent le même fardeau : l’impossibilité de passer en Europe, depuis que celle-ci a durci le contrôle de ses frontières, et donc un séjour – souvent illégal – qui se prolonge au Maroc, dans des conditions à la limite de l’indicible…
Dans leurs récits, les conflits familiaux se mêlent à la pauvreté, aux violences et aux espoirs déçus. Aminata a « pris la route » après le décès de son second mari. Elle avait déjà dû se remarier avec le frère du premier, et devait cette fois épouser leur père, mais cette perspective continue à lui faire horreur. « Je préfère prendre du poison et mourir », assure cette belle femme, sans nouvelle depuis trois ans de ses jumeaux et de son bébé de 6 mois, tous laissés à son frère. Sa première tentative de traverser la Méditerranée a tourné à la catastrophe : « Nous étions 56 dans un canot pneumatique. Quand il a coulé, j’ai vu tous les autres mourir. Je me suis accrochée à une planche et des pêcheurs m’ont récupérée le lendemain. Jamais je ne réessaierai. »
RESTER AU MAROC OU RENTRER AU PAYS
Comme beaucoup d’autres femmes venues de tous les pays d’Afrique, Aminata découvre depuis deux ans la dure vie de migrante sans papiers, victimes de tous les trafics et de tous les abus. Son avenir ? Elle ne l’envisage qu’avec angoisse : « Peut-être vais-je demander à l’OMI (NDLR : l’Office des migrations internationales) de m’aider à rentrer chez mon frère, en Centrafrique. Je prie Dieu qu’il m’aide à trouver une solution d’ici à la fin de l’année… » Jacky, elle aussi, a laissé un fils de 8 mois en RD-Congo quand elle a – comme toute sa délégation – profité d’une compétition sportive en Algérie pour tenter la traversée. « Vu la situation dans mon pays, la famine, la guerre, je pensais vivre mieux », résume cette ancienne spécialiste du 100 et 200 mètres. Une récente ordonnance royale pourrait lui ouvrir la voie d’une régularisation. Mais, comme d’autres, la jeune femme rechigne à envisager son avenir au Maroc, et par exemple à inscrire ses fils de 5 ans et 2 ans à l’école marocaine, où « ils apprendraient l’arabe ». « Je vais rentrer au pays. Ma famille sera déçue : sept ans pour rien… mais elle va m’accueillir », espère-t-elle.
Nigérienne d’origine, chargée de l’accueil au SAM, Sahiya enregistre à longueur de journées les histoires et les besoins de ces femmes. « Certaines partent sans savoir les difficultés qu’elles vont rencontrer en chemin, plusieurs se font violer en route, ou bien le passeur a pris papiers et argent et a disparu », égrène la jeune femme, qui, lors de ses visites à domicile, voit parfois « quatre mamans partager une même chambre avec leurs enfants ». Certaines essaient d’être enceintes au moment de la traversée, pour obtenir l’asile à l’arrivée, ou voyagent avec l’enfant d’une autre… « Parfois, en tant que sœur, je leur dis qu’elles n’auraient jamais dû partir mais plutôt investir la somme que leur a confiée leur famille dans un commerce. Et d’autres fois, je ne peux retenir mes larmes. »
« J’ADMIRE LEUR ESPÉRANCE »
Dans cet océan de détresse, le SAM a progressivement étendu ses propositions. Une infirmière bénévole prodigue ses conseils et ses soins aux mères et à leurs enfants. Quelques classes accueillent les enfants de maternelle et ceux qui arrivent en cours d’année, et leur fournissent un repas par jour et un goûter. « Mais nous ne sommes pas une école. Nous les incitons, dès que les enfants en ont l’âge, à rejoindre l’enseignement marocain », insiste Fanny Curet, l’une des deux responsables du centre, volontaire de la Délégation catholique pour la coopération (DCC). Depuis peu, une assistante sociale marocaine, Bahija Sahsah, a rejoint l’équipe, relais précieux avec l’administration marocaine. « Pour faire valoir ses droits, il faut connaître la langue, la législation », reconnaît cette professionnelle qui a découvert la situation des migrants en rejoignant le SAM et dénonce les « préjugés » des Marocains, quand d’autres n’hésitent pas à parler de « racisme ».
« On essaie de faire quelque chose, mais c’est au compte-gouttes », soupire Sœur Eliza. Cette franciscaine missionnaire de Marie est responsable du service éducation, et à ce titre confrontée au problème numéro un : « l’assiduité » aux cours. Aujourd’hui, Élias, arrivé en classe gravement brûlé le lundi avant d’être soigné à l’hôpital, n’est pas venu, alors qu’il aurait fallu refaire son bandage. « Les mères ont tellement de problèmes, l’éducation n’en est qu’un parmi d’autres, fait valoir cette sœur d’origine indienne. En quoi est-ce leur faute s’il y a la guerre, la pauvreté dans leur pays ? J’admire leur espérance. Elles voient la période actuelle comme transitoire. Pour elles, demain sera forcément meilleur. »
Anne-Bénédicte Hoffner (envoyée à Casablanca)
(1) Créé en 2008 par le Jesuit refugee service, il vient d'être repris par la Caritas.
La Croix, le 17 Juin 2014