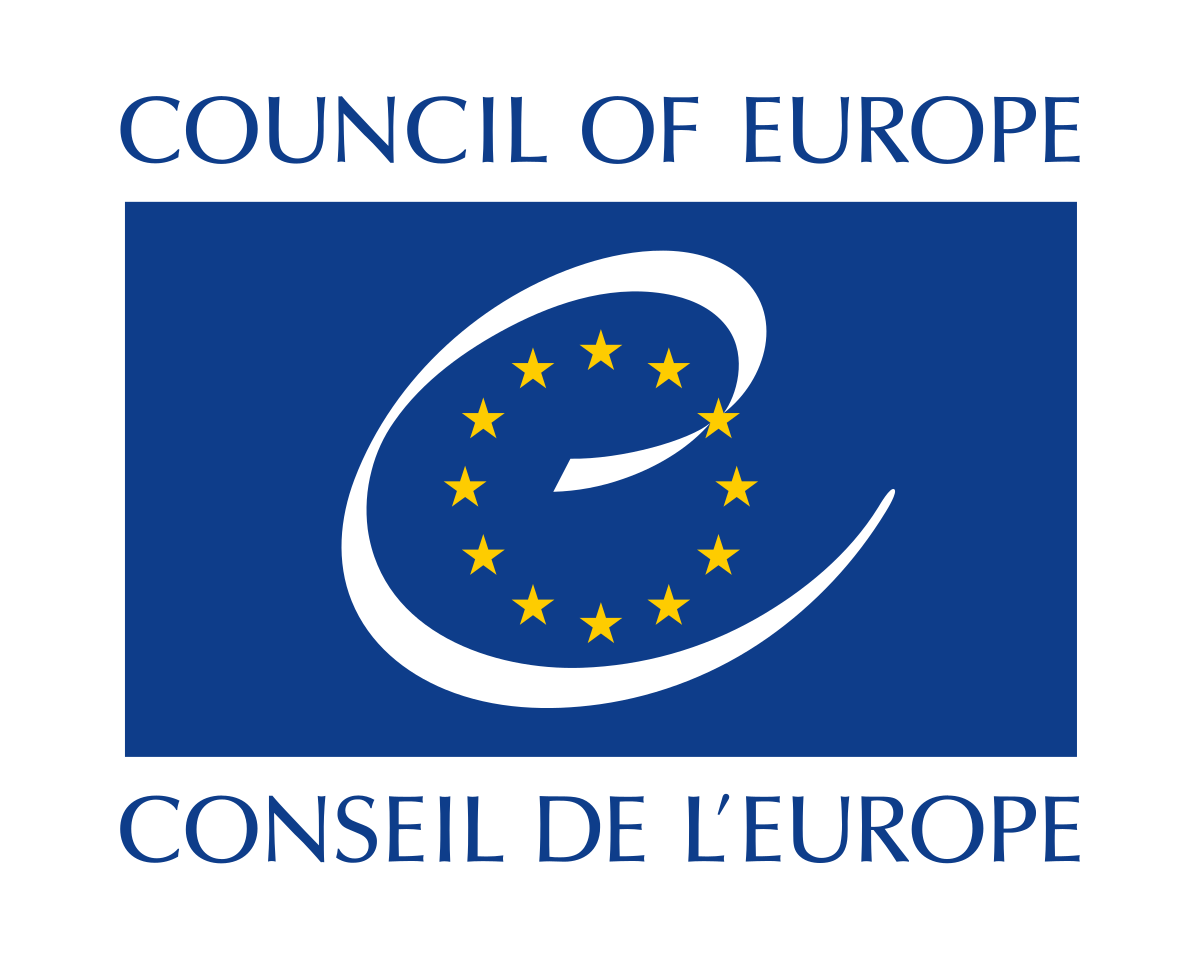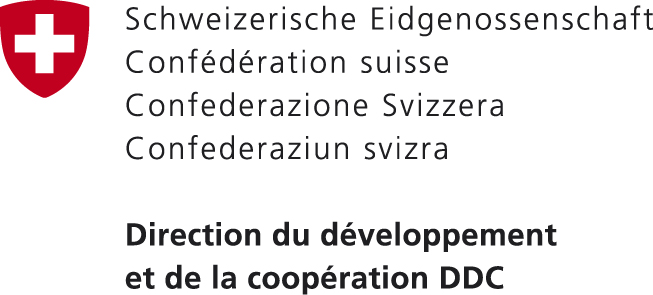Entrée clandestine en Turquie : les réfugiés syriens soumis à la "loi de la forêt"
 Deux personnes attendent qu'un camion entrant en Syrie revienne au poste frontière d'Oncupinar, près de Kilis en Turquie, le 9 février 2016. Photo BULENT KILIC. AFP
Deux personnes attendent qu'un camion entrant en Syrie revienne au poste frontière d'Oncupinar, près de Kilis en Turquie, le 9 février 2016. Photo BULENT KILIC. AFP
REPORTAGE:
"Les passeurs [...] sont méchants, violents, ne pensent qu'à l'argent", explique Fatima al-Ahmed, qui a fui Alep.
La décision turque de fermer sa frontière avec la Syrie fait la fortune de familles de passeurs, qui font payer chaque jour davantage aux réfugiés syriens fuyant les bombardements dans le nord du pays leur passage clandestin en Turquie.
Comme les clans mafieux qui prospèrent en poussant à la Méditerranée des milliers de migrants, ces contrebandiers, le plus souvent des villageois dont les champs jouxtent les grillages, rackettent, rudoient et exploitent les réfugiés syriens qui se refusent à attendre, dans des camps de toile surpeuplés, une hypothétique ouverture par Ankara de ses postes-frontière.
Fatima al-Ahmed, 27 ans, attablée dans un café en plein air à Kilis, dans le sud de la Turquie, a franchi il y a une semaine, son fils de 2 ans dans les bras, les barbelés découpés entre les oliviers. Elle a décidé de fuir son quartier de Sakhour, tenu par les rebelles dans l'est d'Alep, quand son mari a péri, il y a un mois, dans un bombardement alors qu'il était sorti chercher de quoi manger.
"Nous nous sommes groupés, à huit, avec des voisins", dit-elle d'une voix douce. "Ils m'ont aidé à payer, je n'avais pas assez d'argent. Avant, tout s'organisait d'Alep, on s'adressait à des passeurs de confiance. Mais maintenant, depuis les bombardements russes, il y a trop de monde. Alors nous sommes partis comme ça".
Après quinze heures d'un trajet effrayant en minibus, entre coups de feu et explosions - 90 minutes en temps normal -, ils arrivent au hameau de Yaaroubié, sur la frontière.
"Les passeurs sont là. Ils crient +Turquie ! En Turquie ! Qui veut aller en Turquie ?+ Ils sont méchants, violents, ne pensent qu'à l'argent", dit Fatima. "Ils nous poussent comme du bétail, frappent les femmes qui ne marchent pas assez vite, même quand elles portent des bébés. C'est terrible, c'est la loi de la forêt".
'Seule face à son destin':
La jeune femme raconte, comme tous les autres réfugiés rencontrés à Kilis, que les passeurs syriens sont en constante relation, par téléphone ou talkie-walkie, avec les passeurs turcs qui vont les prendre en charge une fois la frontière passée.
"Ils nous ont fait attendre, assis par terre sous les arbres, que ce soit l'heure. L'heure à laquelle les soldats turcs qu'ils ont payés sont de garde et regardent ailleurs pendant que nous passons", dit-elle. Son épopée lui a coûté près de 300 euros, tout l'argent qu'elle avait, et même davantage.
Cette somme, la famille d'Ahmad, un adolescent rachitique de 14 ans qui n'en paraît que 11, ne l'avait pas. Trop pauvre, il était parmi les derniers à survivre dans les ruines de son quartier de Marjé à Alep. Quand un baril d'explosifs jeté d'un hélicoptère a tué deux de ses frères qui gardaient leur mouton dans un terrain vague et blessé leur père, la famille s'est entassée dans un camion.
"On ne pouvait pas payer les passeurs, alors on s'est cachés. On a rampé jusqu'au grillage, on s'est glissé dessous" dit, les yeux brillants de malice, ce garçon qui n'est jamais allé à l'école. "On a eu de la chance, les gendarmes turcs nous ont trouvés. Mais comme nous étions avec beaucoup d'enfants, ils ne nous ont pas renvoyés. Ils ont même appelé un bus".
A Kilis, le flot de réfugiés clandestins est en train de se tarir: signe que les consignes de fermeture données aux garde-frontière turcs sont mieux appliquées, le prix du passage s'envole. On évoque 500 voire 1.000 dollars.
Dans son fast-food ouvert il y a deux ans, Yazan Ahmad, 35 ans, attend depuis trois semaines l'arrivée de ses parents qui ont fui le bourg de Tall Rifaat, pris par les milices kurdes. "Ils sont dans un camp, juste de l'autre côté", dit-il. "Hier soir, mon frère a payé des passeurs, tenté de les faire sortir... Mais ils ont échoué. Les Turcs ont tiré au-dessus de leurs têtes".
Et puis il y a les pauvres entre les pauvres. Ceux qui, dépourvus de tout, sont prisonniers de la guerre.
"Ma voisine à Alep, seule avec cinq enfants, vit au dernier étage", soupire Fatima Al-Ahmed. "Je lui ai parlé hier. Elle pleurait. Elle est face à son destin..."