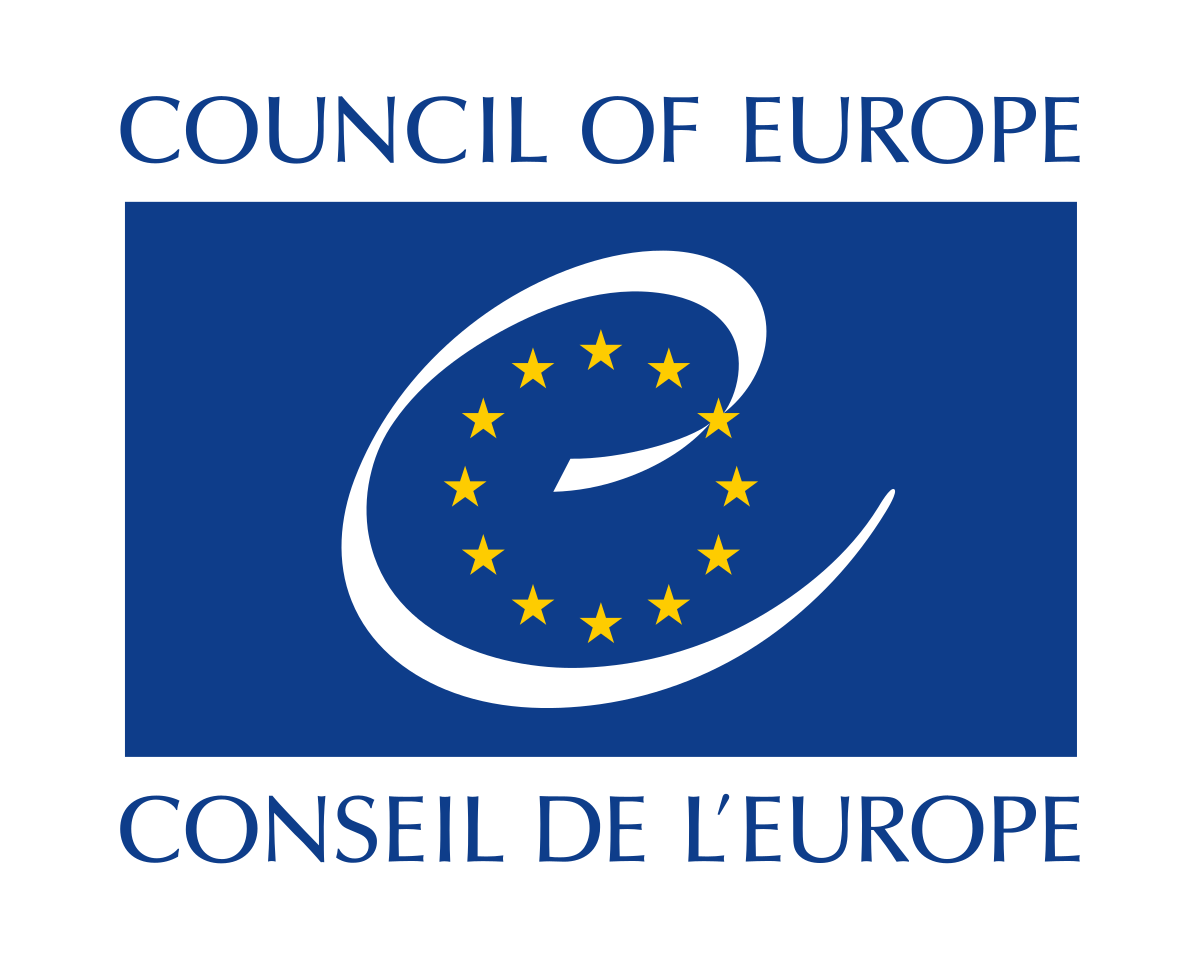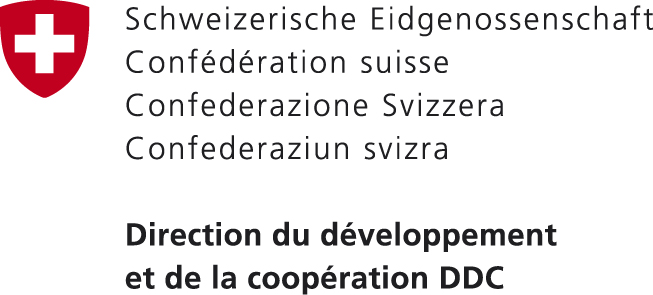Vendeuses ivoiriennes à Tunis, confinées dans la précarité

Il y a quelques années, dans la banlieue nord de Tunis, un petit groupe de femmes, principalement originaires de Côte d'Ivoire, s’est installé un matin dans un marché principalement géré par des hommes tunisiens. Avec le temps, en vendant des produits de leur pays d'origine, ces femmes sont devenues un point d'ancrage pour la communauté subsaharienne, grandissante dans le quartier. Avec la fermeture du marché pendant l’épidémie du Covid-19. ces vendeuses ont été plongées pendant plusieurs semaines dans un confinement précaire.
Au cours des dernières années, le marché a subi une transformation si discrète que personne dans le quartier n'est capable de situer précisément quand cela s’est produit. Entre 2012 et 2016, plusieurs femmes, principalement originaires de Côte d’Ivoire, ont intégré le groupe de vendeur·ses.
Chaque dimanche, sur le passage qui sépare la partie haute et basse du marché, ces femmes recouvrent le sol avec des étoles de tissu sur lesquelles elles vendent des paquets d'épices, de pâtes, d'herbes médicinales... Ces marchandises emballées à la main proviennent d’endroits qu'elles appelaient auparavant "chez elles".
Depuis que des mesures contre l'épidémie du Covid-19 ont été prises en mars, le marché de Bousalsla a fermé. Seules quelques mauvaises herbes ont poussé là où les tentes et les kiosques se dressaient autrefois. Ces femmes, comme de nombreux·ses autres Subsaharien·nes sans-papiers, ont été livrées à elles-mêmes, sans aucune source de revenus, sécurité sociale, ou protections légales. Trois vendeuses ivoiriennes et deux de leurs client·es se sont confié·es sur ce que le marché représentait pour elles et eux et comment le confinement a affecté leur vie et leurs projets d'avenir.
Débuter à son compte
Estelle* commence à vendre des articles sur le marché en février, seulement un mois après son arrivée en Tunisie et son installation dans le quartier, un des principaux lieux de résidence des Subsaharien·nes à Tunis. L'idée lui vient d'un coup après avoir rencontré des femmes ivoiriennes qui vendaient des produits de leur pays d'origine sur le marché. Motivée, elle se dit : "Pourquoi pas moi ?” Elle se précipite chez elle et appelle sa sœur censée la rejoindre à Tunis deux semaines plus tard, pour lui énumérer les produits qu'elle doit apporter de Côte d'Ivoire.
Son premier jour de vente "est parfait". Estelle se rend au marché à 7 heures du matin, son bébé bien emmitouflé sur le dos et ses produits enveloppés dans un grand foulard. Elle trouve une place libre à côté de deux femmes ivoiriennes qu'elle appellera plus tard ses "camarades". Ce jour-là, elles ne l'accueillent que brièvement avant de retourner à leurs affaires.
Sur son foulard, Estelle dispose soigneusement des paquets de gombo séché, de plakali (pâte de manioc), d'attieke (manioc fermenté), de thé bissap (hibiscus), de beurre de karité et autres produits cosmétiques. Après son premier jour de travail, la jeune femme de 27 ans rentre fièrement auprès de ses trois enfants et de son mari avec près de 100 dinars en poche. "Je me suis dit que si je pouvais continuer, cela m'aiderait vraiment", se souvient-elle.
Au neuvième dimanche, alors qu'elle se rend au marché, Estelle aperçoit au loin des policier·es puis des vendeur·ses se préparant à partir à contrecœur. Le gouvernement tunisien vient d'annoncer le début du confinement général.
Estelle est contrainte de faire demi-tour et de retourner dans la petite maison qu'elle partage avec cinq autres adultes et ses trois enfants. "Rien ne va plus", dit-elle avec regret. La promesse d'une vie prospère en Tunisie s'estompe de semaine en semaine.
Léna*, 33 ans, a également trouvé son premier travail au marché de Bousalsla. En mai 2019, elle quitte son domicile et ses deux enfants en Côte d'Ivoire pour venir s’installer en Tunisie avec le rêve de décrocher un diplôme d’aide-soignante. Sa tante, qui y a déjà vécu, encourage Léna à s’y installer. Selon cette dernière, "c'est le pays le moins raciste du Maghreb". "Elle m'a dit que c'était bien et qu'il ne fallait pas apporter beaucoup de vêtements parce qu'ils ne sont pas chers et faciles à trouver là-bas". Léna suit les conseils de sa tante et remplit deux valises avec ses produits ivoiriens préférés : pâte d'arachide, mélanges d'épices, ignames (yams), plantains, huile de palme rouge, gingembre d'Afrique occidentale et produits cosmétiques.
La mère de famille espérait travailler comme nourrice pour financer ses études, mais trouver un emploi s'avère plus difficile qu'elle ne le pense. Son réseau de nounous ivoiriennes l'encourage à devenir vendeuse à Bousalsla tout en continuant à chercher une famille. C’est ainsi que de nombreuses femmes subsahariennes ont survécu à leurs premiers mois à Tunis, jusqu'à ce que leur stock de produits soit épuisé.
Lors de son premier matin sur le marché, une Congolaise dirige Léna vers une place disponible dans la rangée. Elle lui indique qu’elle doit payer trois dinars à un Tunisien pour l'entretien du lieu. La jeune femme, qui a une certaine expérience dans la vente sur les marchés d'Abidjan, trouve parfaitement sa place à Bousalsla. Cependant, elle est surprise par le fait que la plupart des vendeur·ses tunisien·nes soient des hommes. La dynamique est à l’opposé de ce qu'elle connaissait chez elle.
"D'où on vient, si vous voyez des hommes vendre au marché, le plus souvent ce sont des Africains non ivoiriens... ce sont des étrangers. En général, ce sont les femmes qui vendent sur les marchés. En Tunisie, c'est différent".
Léna a pu vivre de ses revenus du marché du dimanche pendant trois mois, jusqu'à ce que son stock s'épuise. Grâce à une connaissance, elle trouve finalement un travail de nourrice à domicile pour une famille turque. Mais au bout de sept mois et avec l’approche de la menace du Covid-19, la famille quitte le pays, laissant Léna sans emploi.
La jeune femme partage un appartement avec quatre autres Ivoirien·nes qui, selon elle, "s'ennuient et sont impatients de retourner travailler". "Nous suivons les règles et restons à la maison. Nous utilisons beaucoup de chlore et nous portons des gants quand nous sortons. Ce n'est pas facile, mais nous espérons que tout ira mieux".
Importer les produits
Rachelle*, trentenaire, vit avec sa fille de 16 mois et ses deux colocataires. Elle a l'idée de devenir la première grossiste ivoirienne de Bousalsla alors qu'elle est enceinte. À ce moment-là, elle a du mal à faire les ménages dont elle se charge depuis trois ans dans le quartier.
Elle remarque alors que ses ami·es ivoirien·nes attendent avec impatience qu'une connaissance viennent de Côte d'Ivoire pour reconstituer leurs stocks. Rachelle saisit l'opportunité et, avec ses économies, décide de fournir ce service.
Elle achète un billet pour Abidjan, fait des courses pendant des jours et revient avec plusieurs sacs remplis de produits ivoiriens. Après un premier essai réussi, elle répète à de nombreuses reprises ce laborieux processus de réapprovisionnement. Mais elle explique que la douane tunisienne lui rend parfois "la tâche très difficile" pour faire passer ses produits. Elle raconte avoir dû payer à plusieurs reprises le double de leur coût, en particulier pour les cosmétiques. "Ils m'ont dit que sinon, ils prendraient les articles et que je pourrais les récupérer au moment où je leur donnerais l'argent".
Au cours de l'année écoulée, Rachelle a étendu sa clientèle à des femmes camerounaises, congolaises, ghanéennes et sénégalaises. Au lancement de son activité, la plupart de ses client·es achetaient des produits pour leur usage personnel ou pour les revendre au marché. Avec le temps, Rachelle voit de plus en plus de femmes se fournir chez elle pour lancer leurs propres projets commerciaux. Elles sont de plus en plus visibles dans ce quartier atypique que se partagent Tunisien·nes et non-Tunisien·nes.
L'une de ses clientes, Monique, est connue dans le quartier pour être la première femme subsaharienne à avoir ouvert son propre salon de coiffure. De plus en plus de femmes tunisiennes se font faire les cheveux et les ongles par des femmes subsahariennes et utilisent des produits importés, affirme la coiffeuse. "Je ne pense pas que j'aurais pu ouvrir un commerce dans le quartier quand je suis arrivée en 2013", explique Monique. Elle précise que les vendeurs·ses non tunisien·nes du marché ont encouragé les commerçantes comme elle à se lancer, malgré leurs chances infimes d'obtenir un statut officiel dans le pays.
Dans l'appartement de Rachelle, qu'elle n'a pas quitté depuis l'annonce du confinement, il ne reste que quelques produits sur les étagères et armoires, dont les prix en dinars sont indiqués sur des bouts de sparadrap. "Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant, mais je ne peux pas sortir pour demander de l'aide à cause de mon enfant. Je ne pourrais plus me regarder en face si elle tombait malade". Rachelle dit qu'elle a de la chance d'avoir des colocataires qui l'aident à s'occuper d'elle et de son enfant.
Un air de chez soi
Miriame, 37 ans, et Ibrahim*, 28 ans, vont toujours ensemble au marché du dimanche de Bousalsla avant de se séparer pour se rendre à l'église et à la mosquée du coin, chacun·e de son côté. En Côte d'Ivoire, il et elle vivaient très éloigné·es l'un·e de l'autre, Miriame dans le Sud chrétien et Ibrahim dans le Nord musulman. Mais à Tunis, il et elle sont voisin·es et partagent beaucoup de choses. Pendant le confinement, les deux ami·es se voient lors de promenades occasionnelles dans le quartier. Il et elle discutent régulièrement des deux enfants de Miriame resté·es à Abidjan, ou des futures étapes de ce qu'Ibrahim appelle "la suite de l'aventure".
Pour les deux, les vendeurs·ses ivoirien·nes jouent un rôle important pour leur communauté à Tunis, où la vie n'est pas aussi confortable que ce qu’on leur avait dit.
“Les gens de chez nous vous disent que la vie ici sera un paradis, que vous gagnerez plus d'argent que là-bas, mais en réalité c'est vraiment difficile ici", dit Miriame.
La jeune femme est venue à Tunis en octobre 2015. Elle y a été encouragée par une amie déjà sur place qu'elle considérait comme une "petite sœur" à Abidjan mais qui est devenue une "étrangère" une fois arrivée en Tunisie.
Les deux ami·es connaissent de nombreux·ses Ivoirien·nes qui ont été escroqué·es au cours de leurs premières semaines passées à Tunis. Ibrahim en fait d'ailleurs partie. Le frère d'un ami avec qui il avait grandi en Côte d'Ivoire lui a volé l'équivalent de plus d'un mois de salaire. Ibrahim a dû repartir de zéro.
De son côté, Miriame a appris à se tenir à l'écart après cinq années de travail à Tunis et admet que "même dans la communauté noire africaine, les gens se marchent dessus pour de l'argent". Malgré tout, Ibrahim croit en une solidarité croissante entre les Subsaharien·nes en Tunisie, surtout après l'assassinat d'un Ivoirien en décembre 2018, acte à connotation probablement raciste.
"Nous devons travailler dur pour survivre ici, nous devons bien manger", dit-il en plaisantant sur la nourriture tunisienne, qui ne fait pas l'affaire selon lui. "C' est du pain, du pain, du pain, tout le monde mange du pain, des spaghettis, des pâtes, du pain, c'est quoi ça ?”, renchérit Miriame, ajoutant que la nourriture ivoirienne est une source de réconfort émotionnel. "Je ne peux pas m'en passer", confirme Ibrahim.
Le fait de partager des produits de chez lui l'a aidé à se faire des ami·es tunisien·nes. “Quand on travaille, ils viennent me voir et me demandent : ‘Mon ami, comment tu fais pour travailler aussi bien ?’ Je leur explique : ‘Je mange ça et me soigne avec ça’. Ils me demandent : 'Si tu vas voir ces femmes, amène-nous de ces produits", rapporte Ibrahim. "C'est comme ça qu'on se fait des amis", ajoute-t-il fièrement.
Un confinement d'un autre genre
Bien qu'elle fréquente des Ivoirien·nes qui lui rappellent tout de même son pays, Miriame est constamment tourmentée par l'envie de rentrer chez elle. Ce qu'elle appelle "l’histoire du Corona" a intensifié ce sentiment.
"Je suis devenue sans-papiers au bout de trois mois, je pensais pouvoir obtenir une carte de séjour, mais mon amie m'a dit de ne pas espérer, que c'était impossible à avoir", se souvient-elle.
Peu de temps après, les pénalités de retard ont commencé puis ont continué à s'accumuler. "Pour tout le temps que vous passez ici, vous devez payer. Vous allez devoir payer. Donc j'essaie de régler ça, maintenant qu'il y a cette histoire de Corona. Vous connaissez l'OIM [Organisation internationale pour les migrations] ? Je ne crois pas qu'ils travaillent en ce moment. C'est ça le problème. Sinon, j'aurais pu aller m'inscrire, pour qu'ils puissent au moins m'aider avec les pénalités pour pouvoir rentrer chez moi", dit Miriame, exaspérée après avoir passé cinq années à comptabiliser anxieusement ses frais de dépassement de durée de séjour de 20 dinars par semaine (environ 25 euros par mois).
Le 3 mai, l'OIM a signalé que le taux d'emploi des migrant·es en Tunisie était passé de 64% à 11% depuis le début du confinement général le 22 mars. En collaboration avec les municipalités, l'organisation a fourni une assistance sociale et économique sous diverses formes aux travailleur·ses sans-papiers. Comme en témoignent les différentes personnes rencontrées, l'accès à l'information et à l'aide reçue ont été rares et désorganisés.
Miriame n’a rien reçu : “Je ne sais pas à quel moment ils vont se déplacer pour venir nous aider." Rachelle, de son côté, a refusé de demander l'aide à l'OIM car elle a entendu dire que l’organisation collecterait les numéros de passeport des bénéficiaires.
Estelle, Ibrahim et Léna sont chacun·e à leur tour allé·es à la municipalité de La Marsa. Estelle a donné son numéro de téléphone et on lui a demandé de rentrer chez elle, Ibrahim a croisé la police à l’extérieur, qui lui a également demandé de rentrer chez lui et Léna a reçu un bon d’achat de 25 dinars pour à dépenser dans une épicerie. Deux semaines après s’être rendue à la municipalité, Estelle a reçu de son côté deux sacs de nourriture.
À Bousalsla, Léna raconte que plusieurs Tunisiens·nes lui ont proposé de payer ses courses. Sa logeuse, qu’elle considère comme une membre de sa famille, ne lui a pas fait payer le loyer du mois d’avril. “On peut vraiment remercier les Tunisiens pendant cette période”, dit Ibrahim qui, alors qu’il se trouvait avec trois amis, a reçu des sacs de courses d’un “donneur anonyme” circulant dans le quartier.
Au-delà de l'immédiateté de la crise, un collectif d'associations subsahariennes s'est réuni sous le nom de Covid-19 African Solidarity Cell. Principalement actif via sa page Facebook, le collectif s'est associé à de grandes marques et distribue avec ses nombreux·ses bénévoles, de la nourriture et des produits de nettoyage aux Subsaharien·nes dans le besoin.
Le 22 avril, le collectif a rencontré Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour proposer des mesures dans le but de protéger les migrant·es pendant la pandémie. Pour l'instant, le gouvernement a suspendu les amendes de dépassement de séjour du 1er mars jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Parmi les suggestions, le groupe a proposé la régularisation des Subsaharien·nes sans-papiers, l'annulation des amendes pour dépassement et la facilitation de l'accès au séjour légal en tant que travailleur·ses. Ils et elles ont également demandé la fermeture des centres de détention où sont placé·es les migrant·es en situation irrégulières.
Une communauté paralysée
Avec la disparition du marché, les habitant·es de Bousalsla ont du mal à rester en contact. "Nous ne savons pas qui souffre et qui ne souffre pas. Nous respectons les règles et restons à la maison", explique Miriame. "Le Corona a paralysé notre communauté", commente Rachelle, "maintenant, seul Dieu peut voir l'avenir".
Personne ne sait encore combien de temps il faudra pour que les marchés comme celui de Bousalsla prospèrent de nouveau, mais le groupe n'a pas le luxe d'attendre. Les stocks de Rachelle s'épuisent. Elle ne peut plus s'imaginer faire des allers-retours entre les deux pays et envisage de retourner définitivement en Côte d'Ivoire.
“Peut-être qu’on est mieux à la maison", dit Rachelle.
Après avoir travaillé pendant 5 ans comme femme de ménage, Miriame veut rentrer chez elle et voir ses enfants, mais elle redoute le contrôle de police à l'aéroport de Tunis-Carthage. "J’espère que tout se passera bien et que je pourrais partir cette année, mais il n'y a que Dieu qui puisse assurer que tout se passe bien et que je rentre. Je ne veux vraiment pas rester ici".
Léna et Estelle souhaitent trouver des emplois stables. Léna veut étudier et essayer de faire une demande de résidence. Quant à Estelle, elle n’a pas vraiment de plan, mais estime qu’il est trop tôt pour retourner en Côte d'Ivoire.
Ibrahim, lui, veut aller ailleurs. "Je ne suis qu’au début de l'aventure. J'ai quitté mes parents et je suis seul ici. Mais maintenant, je prie Dieu pour ne pas rester. Je veux continuer. J’irai là où Dieu me mènera."