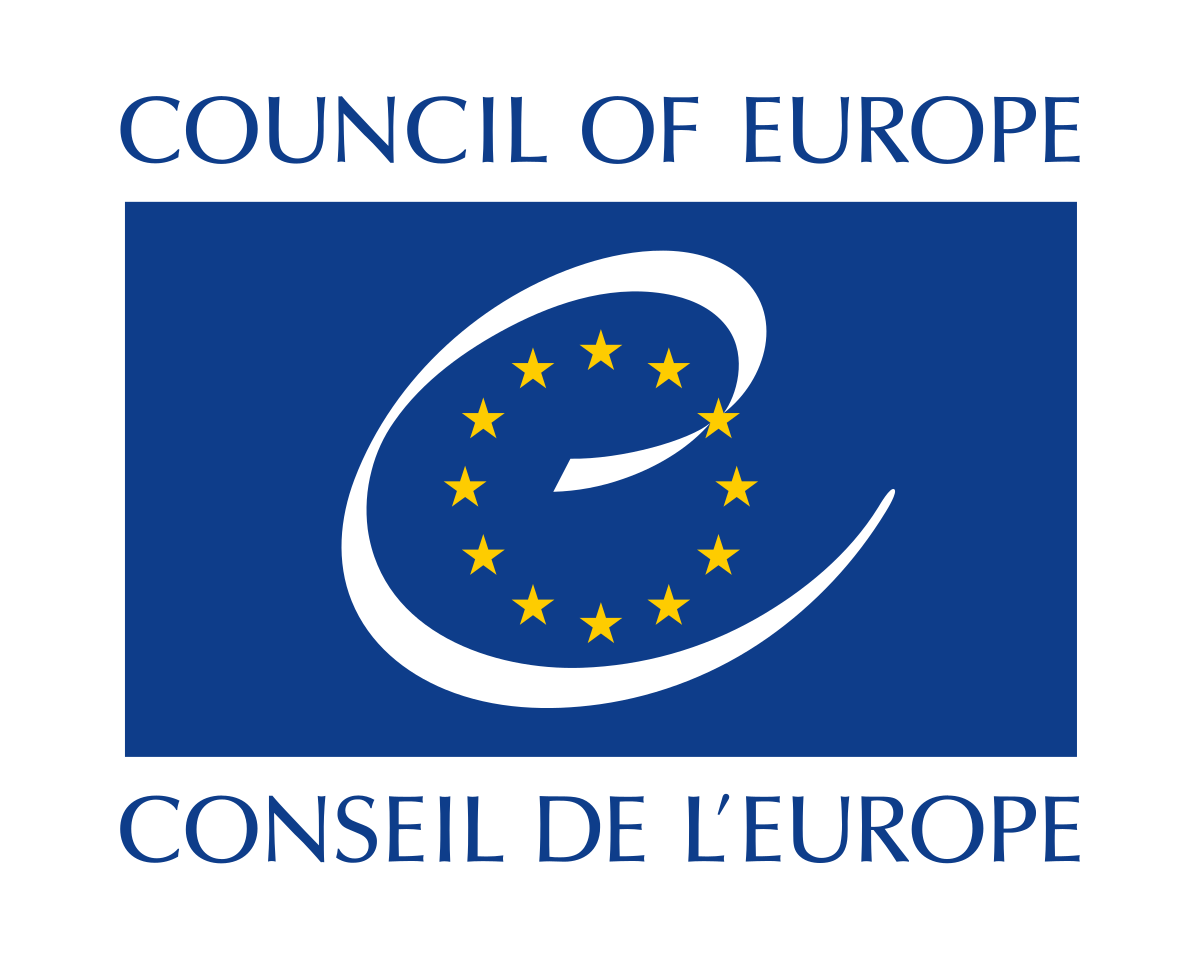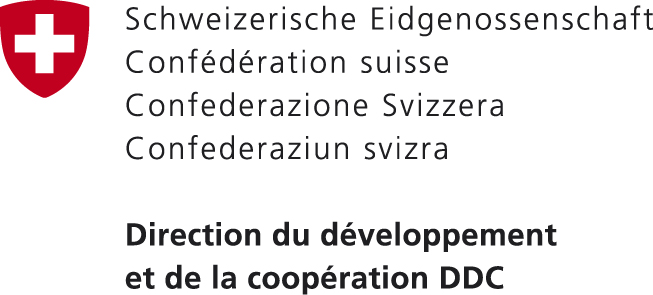Les migrants, ces damnés de l’économie tunisienne

Insécurité, exploitation professionnelle, menaces d’expulsion, le système tunisien mène la vie dure aux travailleurs originaires d’Afrique subsaharienne, jusqu’à parfois mettre leur vie en péril. Les témoignages accablants se succèdent.
Leur présence est chaque année plus visible en Tunisie. De prime abord, rien ne les distingue des étudiants, comme eux, originaires d’Afrique subsaharienne. Pourtant, la réalité des travailleurs migrants est tout autre.
À Sfax, cœur battant de l’économie tunisienne, ils sont nombreux à être employés dans des ateliers ou dans le secteur agricole, systématiquement sans contrat.
L’informel est souvent la seule option pour ces étrangers, pour la plupart en situation irrégulière. « L’accès à un emploi légal est très compliqué. Du coup, l’exploitation devient très vite la norme. On peut te confisquer ton passeport, tu as une charge de travail très importante, tout ça se banalise », explique à Middle East Eye Mahmoud Kaba, ancien chargé de mission auprès de l’association Terre d’asile Tunisie.
Passeports confisqués
Les ouvriers sont parfois amenés à prendre des risques inconsidérés, notamment dans les usines où certains sont contraints de manipuler des machines dangereuses. « On a beaucoup d’accidents du travail parce que les gens ne sont pas formés. Si tu cherches un emploi, on t’emmène sur place, on t’explique pendant cinq minutes et c’est parti… », décrit à MEE Ibrahim*, membre d’une association qui aide les Ivoiriens actifs de Sfax.
Les blessures sont courantes, et si, d’après les sources consultées par MEE, deux décès ont été recensés ces deux dernières années, ce chiffre semble largement sous-estimé : en Tunisie, personne ne tient de décompte et, avec le temps, le sort de ces victimes finit par être oublié.
En février 2019, les médias tunisiens évoquaient le cas d’un ouvrier ivoirien mort d’épuisement, un homme d’affaires, suspecté de mauvais traitements, avait été accusé d’avoir séquestré et exploité des étrangers, notamment en les faisant travailler plus de seize heures par jour.
Achille*, militant local et défenseur des droits des migrants, signale à MEE le décès en 2018 d’un Burkinabé, mort de fatigue : « Son patron ne voulait pas le laisser aller à l’hôpital, il travaillait dans une ferme où il habitait » rapporte-t-il. Comme lui, les ouvriers agricoles vivent généralement sur leur lieu de travail, dans des logements insalubres. « C’est pratique pour les patrons. Ce sont des zones éloignées [du centre-ville] et ils n’ont pas à assurer leur transport tous les jours. »
À des milliers de kilomètres de chez eux, coupés du monde, ces travailleurs, dépendants en termes de nourriture, semblent à la merci de leurs employeurs : leurs passeports confisqués, ils sont parfois contraints de travailler gratuitement pendant plusieurs mois afin de rembourser les frais d’acheminement versés par leur patron à des intermédiaires.
C’est ainsi que fonctionnent les réseaux de traite d’êtres humains qui ont tissé, au fil du temps, leur toile entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire.
Drame humain
Loris*, 30 ans, a été recruté à Abidjan et est arrivé à Sfax en octobre 2017. Si ce miraculé souhaite aujourd’hui tourner la page, un de ses proches rompt le silence.
« Loris regrette d’être parti », confie à MEE le jeune Ivoirien qui s’improvise narrateur d’une histoire qui n’est pas la sienne. « Quand tu arrives, et que tu ne trouves pas ce que l’on t’avait promis, tu te rends compte de la réalité de la vie en Tunisie. »
En 2017, Loris débarque sur une grande ferme, qu’il n’arrive pas à localiser précisément. Il sait juste qu’elle se situe à une trentaine de kilomètres de Sfax. Pour rembourser les intermédiaires, il devra travailler pendant cinq mois sans être payé. Les ouvriers dorment dans une petite chambre. « Ils étaient deux ‘’noirs’’ pour tout faire. C’était très difficile. »
En décembre, l’un des travailleurs est remplacé : « C’est alors un enfant qui arrive sur le site pour prendre le relais. Il avait 21 ans tout au plus, et était clairement trop jeune pour ce boulot. Il faisait pitié », rapporte l’ami de Loris. Le jeune travailleur se fait appeler Joël*. « Il ne disait pas grand-chose. Il était timide ou peut-être perturbé. En tout cas, il était triste. »
Les cadences deviennent vite insupportables, le nombre d’heures de travail explose. Loris tombe malade et perd connaissance à plusieurs reprises. « Le patron s’est contenté de ramener un tube de Doliprane. Son état de santé ne le préoccupait pas trop », explique son ami. Loris, lui, va de plus en plus mal et son employeur finit par lui accorder un peu de repos, sans jamais l’emmener à l’hôpital ni consulter de médecin.
5 janvier 2018. Joël et Loris se lavent, préparent à manger. Mais ce soir-là, ils n’ont pas faim. « Ils ont laissé la nourriture et sont partis se coucher. Ils ont fermé la cuisinière, mais pas le gaz. »
Loris est le premier à se réveiller, aux environs de 22 heures. « Il n’arrivait plus à respirer, il n’avait plus de forces. Il a appelé au secours, Joël ne répondait pas », rapporte son ami, qui poursuit le récit de cette soirée cauchemardesque.
Loris réussit à ramper jusqu’à lui et le trouve inanimé. Il s’empare de son portable et appelle le patron « avec le peu d’énergie qu’il lui reste ». « ‘’Si tu ne viens pas me chercher pour me conduire à l’hôpital, je vais mourir !’’ : voilà ce qu’il lui a dit. »
Quand l’employeur arrive enfin sur les lieux, il se fige en découvrant les deux ouvriers en train d’agoniser. Il parvient à les extirper de la pièce, mais ne sait que faire ensuite. Il enchaîne les coups de téléphone, demande conseil à ses frères. « On a perdu une heure… Joël est mort à l’hôpital », rapporte l’ami de Loris. Le décès de ce jeune Ivoirien pourrait être le troisième à Sfax en l’espace de seulement deux ans.
Préférence nationale
La trajectoire de Joël rappelle celle de toutes les victimes de la traite d’êtres humains dans cette ville du sud tunisien. La législation en vigueur dans le pays – avec notamment l’article 258-2 du code du travail qui encadre le travail des étrangers – rend les migrants particulièrement vulnérables, avec un code du travail basé sur la règle implicite de la préférence nationale.
Tel qu’il est écrit, le texte empêche ces travailleurs étrangers d’accéder à une activité déclarée et contribue à créer des situations d’exploitation avérées. Contactée par MEE, l’Association pour le leadership et le développement en Afrique (ALDA), qui milite notamment pour les droits des migrants, remet en cause « l’approche officielle » : « L’État tunisien ne souhaite pas régulariser le travail des étrangers pour ne pas créer un effet d’appel d’air. Ce n’est pas explicite mais on comprend très bien que c’est ça. »
L’organisation y voit la conséquence des pressions exercées par l’Union européenne sur les pays de la rive sud de la Méditerranée. Pourtant, en Tunisie, plusieurs secteurs de l’économie peinent à recruter, faute de candidats.
Selon le sociologue Vincent Geisser, qui répond à MEE, il y a « une hypocrisie systémique » : « D’un côté, on obéit aux injonctions européennes en matière de contrôle des flux migratoires, d’un autre côté on laisse faire les acteurs privés pour qu’ils profitent d’une main-d’œuvre bon marché non déclarée. »
Alors, quand il apprend la mort de Joël, Loris s’effondre. Il reste à l’hôpital une semaine et reçoit la veille de sa sortie la visite de trois policiers, venus l’auditionner. C’est le seul contact qu’il aura avec les autorités concernant l’affaire.
Maître Mohamed Wajdi Aydi, l’avocat de Terre d’asile Tunisie, qui suivait le dossier à l’époque, se souvient : « La décision du juge d’instruction tenait sur deux pages. Absence de crime, non-lieu. Ce dernier ne peut pas prendre la décision d’inculper le patron s’il ne trouve pas de négligence » résume-t-il à MEE.
L’affaire est classée. Le corps de Joël est rapatrié en Côte d’Ivoire, sans que son employeur ne mette la main à la poche.
« À chaque fois c’est la même chose, le patron est arrêté au moment de l’accident et relâché après », déplore Achille, le défenseur des droits des migrants.
« On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de suites données à ces affaires, du coup on ne garde pas les dossiers, cela ne nous sert à rien et nous expose pour rien… En parler, cela veut dire pour eux salir l’image de la Tunisie », poursuit-t-il.
La législation en question
Pourtant, la justice reconnaît depuis peu les crimes de traite. La Tunisie s’est dotée en 2016 d’une loi relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes.
En février 2017, une instance chargée de coordonner la stratégie nationale a vu le jour afin de combattre ce fléau. « Puisque Joël était une victime potentielle de la traite, nous avons pris tout le dossier et nous l’avons remis à cette instance pour qu’elle poursuive le travail », retrace Mahmoud Kaba, de Terre d’asile Tunisie.
Mais dans les faits, l’impunité règne encore. En quatre ans, il n’y a eu qu’une seule condamnation, alors même que « le nombre de crimes de cette nature augmente en Tunisie », comme l’affirme dans une note de synthèse l’ONG Avocats sans frontières (ASF), qui a publié en juillet 2019 une étude sur le traitement de ces affaires. Les conclusions de l’ONG sont sans appel.
Il y a « un manque de capacités judiciaires en la matière, une lenteur extrême des poursuites, ainsi que de nombreuses lacunes au niveau de l’accompagnement des victimes ».
C’est certainement ce dernier point qui est le plus déterminant dans le cas des travailleurs Africains subsahariens : « Les victimes étrangères de traite, du fait de leur vulnérabilité, évitent de porter plainte ou d’aller jusqu’au terme du processus judiciaire », écrit ASF. Pire, on leur propose systématiquement de rentrer dans leur pays d’origine. « Dans la majorité des affaires, les victimes choisissent cette option, leur retour ‘’volontaire’’ étant facilité par le programme des Nations unies. »
Dans l’affaire de Sfax, Loris a ainsi refusé de porter plainte, alors même que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) l’incitait à le faire. « Il a eu peur. Il craignait pour sa vie », explique son ami. Une histoire qui met en lumière les failles du système judiciaire tunisien autant que les limites des organisations internationales.
Broyé par le marché de l’emploi
En Tunisie, aucun observateur averti ne semble attendre de changement de la part de la classe politique. Après des années de tabou, la révolution de 2011 avait pourtant libéré la parole des associations sur les questions migratoires, dont les critiques avaient pu être « relayées dans les plus hautes sphères », comme l’explique Vincent Geisser.
Ce dernier constate aujourd’hui une « normalisation et un réalignement de la Tunisie sur la politique européenne » où « le relais institutionnel, parlementaire et gouvernemental est très réduit. »
Ainsi, les dirigeants tunisiens ont accepté l’idée de traiter l’immigration comme un problème sécuritaire et ne remettent plus en cause la stratégie européenne d’externalisation des frontières de l’espace Schengen.
Mais Vincent Geisser souligne à l’inverse « le maintien du dynamisme de la société civile et de la société tunisienne dans son ensemble, particulièrement au niveau local, qui restent attachées à cette question-là, avec un véritable mouvement de solidarité ».
Désormais, c’est le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) qui apparaît comme le fer de lance de ces organisations engagées en faveur d’un meilleur accueil des migrants.
Aujourd’hui encore, Loris est persuadé d’avoir pris la bonne décision. « Il ne peut pas porter plainte, il dit qu’il n’est pas chez lui », explique son ami à MEE. Après l’accident, il a quitté Sfax quelque temps. Il s’est réfugié à Tunis où il a travaillé sur un chantier de construction.
Mais la vie du jeune homme bascule de nouveau, après une chute du deuxième étage d’un bâtiment : il s’en tire avec un bras cassé. « Le peu d’argent qu’il avait épargné, il l’a dépensé pour se soigner, le responsable du chantier n’a rien payé », témoigne son ami.
Aujourd’hui, Loris est retourné à Sfax. Il a repris le travail dans le bâtiment. Dans l’illégalité, le migrant n’a aucune protection ni juridique, ni sociale. Broyé par le marché de l’emploi, soumis à l’exploitation et la précarité, il est condamné à vivre les mêmes souffrances, encore et encore, comme Sisyphe poussant son rocher au sommet de la montagne d’où il finit toujours par dégringoler.
*Ce reportage a été réalisé avant le début de la pandémie. Les prénoms ont été modifiés.
Par Fatima-Ezzahra Bendami et Matthias Raynal, publié sur Middle East Eye le 27 août 2020.
Photo: Des migrants d’Afrique subsaharienne font la queue pour recevoir de la nourriture dans un immeuble loué par le Croissant-Rouge tunisien, dans le port sud-est de Zarzis, près de la frontière avec la Libye, le 4 mai 2015 (AFP)