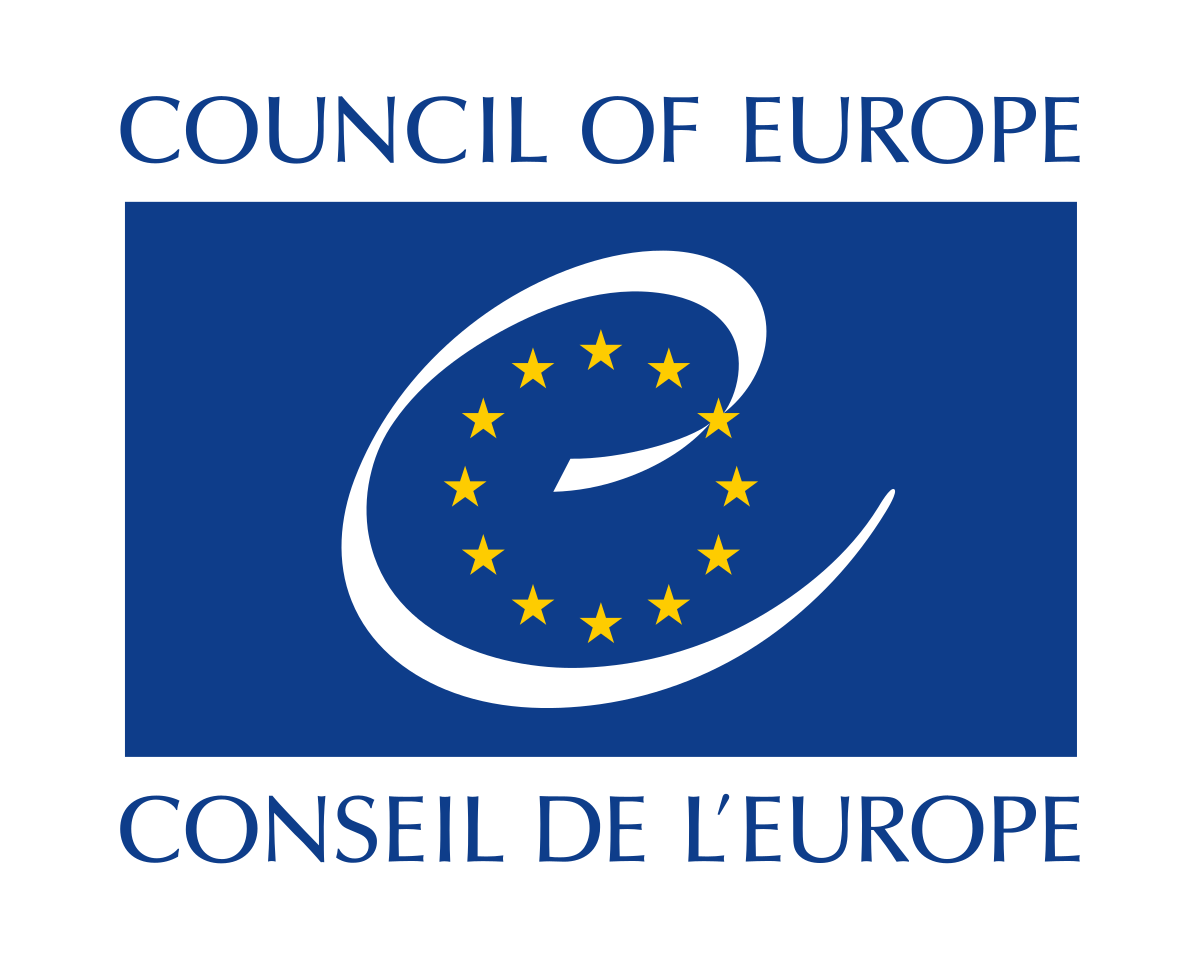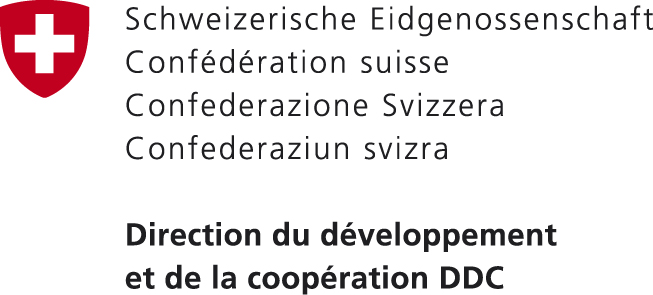Comment le coronavirus a poussé des centaines de Subsahariens à quitter l’Algérie pour la Tunisie

Dès février, des groupes de migrants ont repris la route pour passer la frontière, faisant craindre un rebond de l’épidémie dans l’ouest.
Il a fallu deux mois à Souleymane et à ses amis pour avaler les 880 kilomètres qui séparent Alger de Kasserine. Deux mois de « taxi mafia » à travers le pays, à errer avec un passeur de village en village, jusqu’à atteindre la Tunisie. « Il faut compter 20 000 dinars (130 euros) pour aller d’Alger à Annaba et après encore 12 000 dinars pour arriver jusqu’à Tébessa, égrène le Togolais de 28 ans. Ensuite, il y a plusieurs étapes où on reste dans des maisons abandonnées, jusqu’à descendre au niveau de Fériana. » C’est là, à un jet de pierre de Kasserine, que la police tunisienne a arrêté le petit groupe de migrants en avril.
A l’instar de plusieurs centaines de Subsahariens, principalement de nationalité nigériane, ivoirienne ou malienne, Souleymane et ses camarades ont quitté l’Algérie pour fuir la crise économique et sanitaire. Une poussée migratoire moins remarquée que celle qui a entraîné des milliers de jeunes Tunisiens vers les côtes européennes cet été, mais qui a donné du souci aux villes sinistrées de l’ouest du pays. A Kasserine notamment, l’arrivée de ces exilés de la crise a fait craindre un emballement de l’épidémie.
Souleymane et ses camarades, parce qu’ils ont été parmi les premiers à passer la frontière, ont été immédiatement pris en charge par la police, placés en quatorzaine et soumis à des tests PCR pour dépister d’éventuelles contaminations au coronavirus. Mais « nous avons été très vite saturés au niveau des centres de quarantaine », se souvient le directeur régional de la santé, Abdelghani Chaabani. « Au pic des arrivées, renchérit Dalèle Mhamdi, médecin et chargée de la cellule de crise locale, nous avions 80 personnes à confiner pour seulement 40 lits de disponibles et beaucoup de personnes étaient testées positives. » Les malades ont dû être réunis dans un centre éloigné de la ville, non loin de la zone militaire du mont Chaâmbi, tristement connu depuis plusieurs années pour être le théâtre d’affrontements entre militaires et djihadistes.
« A “l’abattoir” »
Le confinement a payé : à Kasserine, on dénombrait cinq cas importés de Djerba en mars, et seulement 34 à la fin août, dont 9 locaux. Mais, si l’épidémie semble sous contrôle, l’état des infrastructures inquiète dans cette ville sinistrée. « Tout le monde sait ici que l’hôpital n’a pas les moyens, confie Shady Rehbi, un Kasserinois chargé de protection de l’enfance à l’Unicef et ex-conseiller municipal. Certains le surnomment même “l’abattoir” tellement il est synonyme d’une mauvaise prise en charge. » Un nouveau service des urgences est en cours de construction mais, en attendant, la plupart des cas sévères de Covid-19 sont transférés dans les hôpitaux des régions côtières comme Sousse et Monastir. Dans le hall de celui de Kasserine, une sorte de sas fabriqué par les étudiants d’une école d’ingénieurs pour filtrer les patients et prendre leur température est déjà cassé et laissé à l’abandon.
Si Souleymane a été, de son propre aveu, « bien traité », tous les migrants n’ont pas bénéficié du même accueil. « Il y avait dix à vingt personnes qui arrivaient chaque jour, raconte Hatem Labbaoui, président du comité local du Croissant-Rouge à Kasserine Nord. Au début, nous avons tout fait pour leur assurer le minimum mais, très vite, nous avons été débordés. Pour les demandeurs d’asile, certaines ONG internationales nous ont fourni des tentes. Mais comment voulez-vous forcer à confiner quelqu’un sous une tente par une telle chaleur ? Sans compter les trajets à faire vers Chaâmbi, en dehors de la ville, où l’eau a été coupée plusieurs fois. »
Dénuement oblige, la peur et la stigmatisation ont parfois pris le pas sur la solidarité. « On en est arrivé à un stade où les étrangers étaient perçus comme des vecteurs de contamination alors qu’il y a aussi eu des Tunisiens revenus des pays du Golfe qui ont contaminé certains membres de leur famille, se désole Borhen Yahyaoui, journaliste radio sur place. En plus, les Subsahariens, une fois qu’ils étaient remis en liberté, se retrouvaient face à des chauffeurs de louage (transport collectif) qui n’acceptaient pas de les prendre à cause de mesures discriminatoires du gouvernorat. »
D’après un décret du gouvernorat publié le 11 juillet, toute personne qui véhicule ou est en contact avec des migrants peut être sujette ensuite à une mise en quarantaine, d’où la frilosité des transporteurs. D’autres villes près de la frontière ont eu des réactions plus radicales. Au niveau du poste frontalier de Melloula, près de Tabarka, dans le nord du pays, certains habitants ont refusé que des migrants arrivés illégalement à la frontière soient confinés sur place le temps de passer les tests.
Au Kef, une ville frontalière du nord-ouest, « beaucoup de migrants nous ont dit qu’ils avaient perdu leur travail en Algérie ou en Libye à cause du Covid. Il y a eu le même afflux qu’à Kasserine à un certain moment, près d’une trentaine de personnes par jour, puis ça a ralenti. Par contre, ça continue côté libyen », assure Lamia Marzouki, présidente du comité régional du Croissant-Rouge au Kef.
« Risques sécuritaires »
Au niveau national, de nombreuses communes et associations se sont mobilisées pour faire face à ces arrivées avec le soutien d’ONG comme Médecins du monde ou l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM) qui ont distribué des kits d’hygiène et de protection individuelle. Mais à Kasserine et au Kef, l’afflux de ces derniers mois a été difficile à gérer. « En général, la frontière tuniso-algérienne n’est pas une route migratoire très prisée à cause des risques sécuritaires. Ce qui est bizarre avec ces arrivées, c’est qu’à chaque fois, les migrants sont interceptés dans des villages différents, à proximité de la frontière. Il ne semble pas y avoir de circuit précis », avance Shady Rehbi.
La Tunisie peine depuis plusieurs années à offrir un cadre législatif adéquat pour régulariser la plupart des migrants présents sur son territoire. « Nous n’avons pas de réelle politique de gestion des flux migratoires, déplore Romdhane Ben Amor, chargé de la communication au sein du Forum des droits économiques et sociaux, une ONG tunisienne. Dernièrement, le gouverneur de Médenine, dans le sud du pays, a refusé d’accueillir davantage de migrants, de façon arbitraire. » Certains, qui avaient passé la frontière libyenne, se sont retrouvés à faire leur quarantaine « sous les oliviers » faute d’accueil, d’après des témoignages.
Quand les mesures de confinement ont commencé à se desserrer à Kasserine, beaucoup des migrants ont déserté la ville pour tenter de se rendre en Europe depuis Sfax, ou bien sont partis vers la capitale. A Tunis, où il a travaillé un moment dans une station de lavage des voitures, Souleymane était payé 400 dinars (124 euros) par mois. Un salaire bien moins élevé que les 400 euros qu’il gagnait comme ouvrier sur des chantiers en Algérie, pendant deux ans. « Mais je préfère être en Tunisie, confie-t-il. En Algérie, on ne pouvait aller nulle part. Les bus ne nous prennent pas, les gens ne nous parlent pas. Et je me suis retrouvé deux fois arrêté par la police sur mon chantier et emmené près de la frontière avec le Niger, en plein désert, pour être expulsé. »
La Tunisie, qui n’avait enregistré qu’une cinquantaine de décès pendant la crise sanitaire, craint aujourd’hui une deuxième vague épidémique. Depuis la réouverture des frontières, près de 2 484 nouvelles contaminations ont été enregistrées et 26 décès.
Par Lilia Blaise, publié sur Le Monde le 3 septembre 2020.
Photo: Kasserine, en Tunisie, fin août 2020. Lilia Blaise