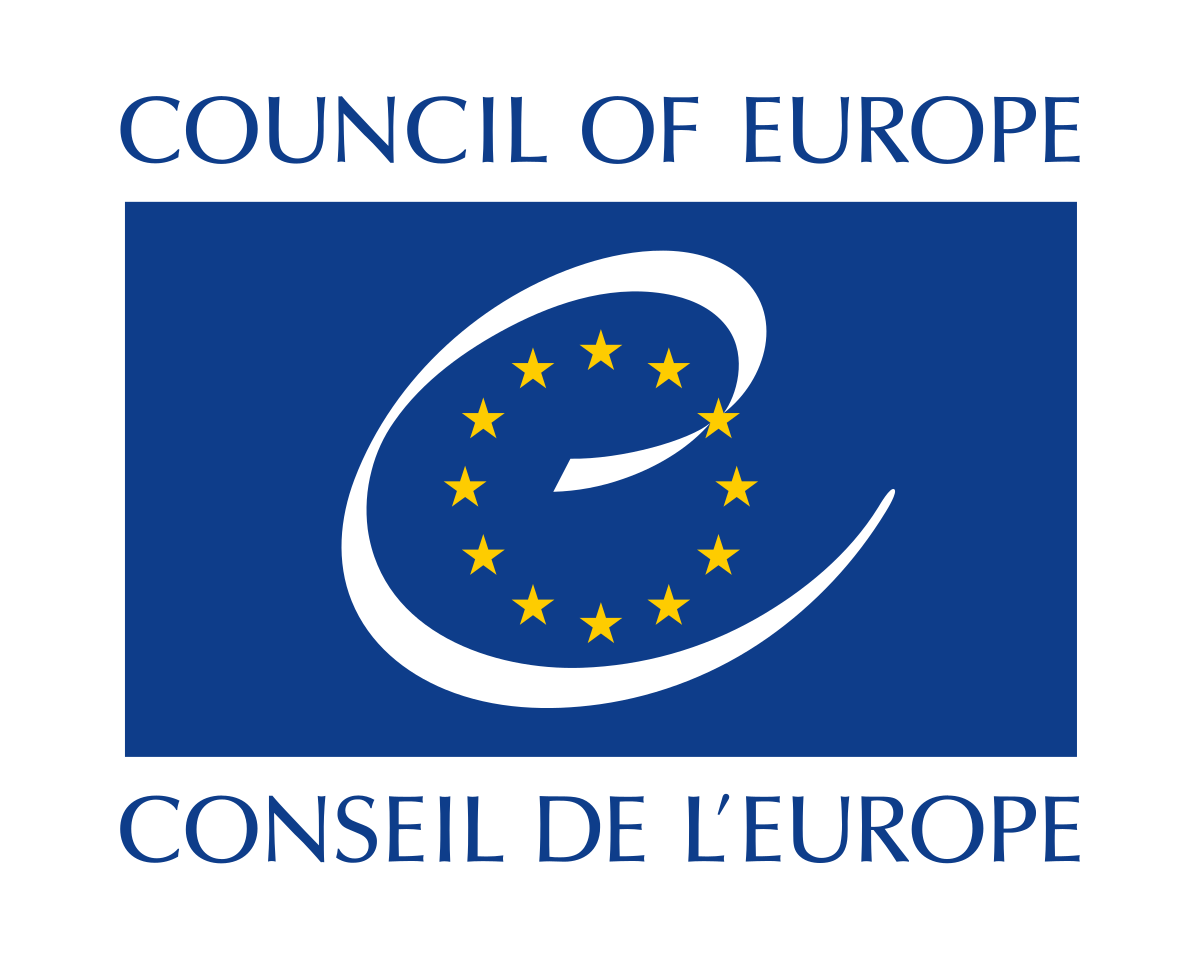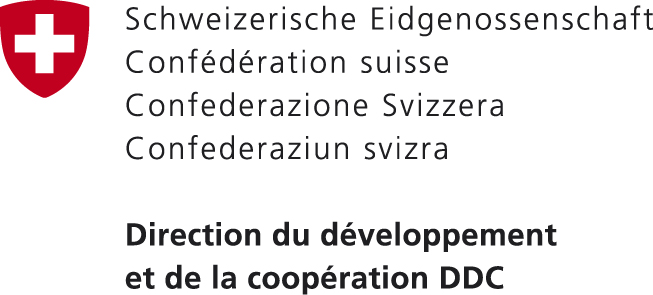« Dans ce centre, on n’applique pas la loi » : El Ouardia, zone grise pour les migrants qui arrivent en Tunisie

En septembre, le centre de détention d’El Ouardia, à Tunis, a dû libérer plusieurs migrants à la suite d’une décision de justice. Aujourd’hui, il est presque vide mais toujours officiellement en activité.
Tout a commencé avec une vidéo envoyée sur Messenger le 2 mars par une militante des droits humains, accompagnée d’un message : « Conditions de détention de nos frères à la prison d’El Ouardia, au sud de Tunis. C’est une caméra cachée. »
On y voit des agents des forces de sécurité tunisiennes, l’un d’entre eux porte un manteau de la garde nationale. Ils sont regroupés autour de deux migrants. Ils discutent mais les esprits s’échauffent rapidement. L’un des détenus se met à crier : « Et pourquoi vous voulez m’envoyer à la frontière ? Moi je suis pas Algérien ! »
Une dizaine de migrants s’interposent puis un agent brandit sa matraque, l’agitant devant le visage de certains d’entre eux pour qu’ils regagnent leurs chambres. « Rentrez ! Rentrez ! », lance-t-il énervé. Il s’engouffre ensuite dans l’un des bâtiments, tout en continuant à crier.
La vidéo documenterait une expulsion forcée. Elle a été tournée à l’intérieur du centre d’El Ouardia, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 février. Middle East Eye a contacté une militante des droits humains qui nous transmet, inquiète, un numéro de téléphone : « C’est un détenu donc je ne peux pas le citer… Ils n’ont pas droit au téléphone, c’est un peu chaud si vous devez le joindre non ? »
À l’autre bout du fil, une voix posée, celle de Rajabu Kilamuna, un Congolais (RDC) de 45 ans, arrivé en Tunisie il y a sept ans. À ce moment-là, il est à El Ouardia depuis vingt jours exactement.
Selon la dénomination officielle, El Ouardia est un « centre d’accueil et d’orientation ». C’est ici que l’État réunit les migrants qu’il estime en situation irrégulière, mais parfois aussi pour d’autres raisons.
Dans les faits, Rajabu Kilamuna n’est pas libre de quitter l’endroit. Il considère qu’il est en prison. Le centre est placé sous l’autorité de la garde nationale, qui dépend elle-même du ministère de l’Intérieur. Ce dernier n’a pas donné suite aux sollicitations de MEE.
Autorisation exceptionnelle
On n’entre à El Ouardia qu’après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle. Même les avocats ne peuvent pas s’y rendre facilement. « On ne peut pas visiter ce centre. Donc, à chaque fois, je contacte le HCR [Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés] ou bien le procureur de la République pour dénoncer l’illégalité de la situation », explique à MEE Alaa Khemiri, un avocat qui a défendu plusieurs migrants.
« Il n’y a aucune information publique sur ce centre, l’État tunisien ne reconnaît pas son existence, c’est fait en cachette, en quelque sorte. »
Ce lieu secret, Rajabu Kilamuna l’a filmé, photographié et n’a cessé de le décrire durant toute la durée de son passage à El Ouardia. Sept mois marqués par les violations des droits de l’homme, la menace du coronavirus et un bras de fer judiciaire.
La vidéo de février provoque un tollé. La société civile réagit. Le Forum pour les droits économiques et sociaux (FTDES) publie un communiqué le 3 mars, dans lequel il dénonce les mauvais traitements, mais aussi « l’expulsion vers la frontière tuniso-algérienne », que sont censées montrer les images.
Maître Alaa Khemiri confirme la pratique : « La police algérienne peut alors arrêter les migrants, refuser de les accepter, et, à leur retour, ils trouvent la police tunisienne qui les emmènent de nouveau à El Ouardia. »
Un jeu de ping-pong, moralement épuisant pour les détenus.
À l’intérieur du centre, ils sont à bout. Rajabu Kilamuna tend le téléphone à Patrick, un Camerounais de 28 ans : « Tout le monde est traumatisé. »
Il dit être venu à pied de Libye, après y avoir été séquestré pendant un an « par des malfrats ». Alors, ce qu’il craint le plus, c’est l’expulsion vers Algérie. « Il est possible qu’ils nous déportent tous. »
Certains sont là depuis longtemps, comme Keïta, 22 ans. C’est en apportant les passeports de ses amis interpellés qu’il a lui-même été arrêté, à Montplaisir, au siège de la police des frontières.
Il s’est jeté dans la gueule du loup. Il a déjà passé plus de trois mois au centre et n’a pas encore obtenu de réponse à sa demande d’asile. Le HCR l’a contacté. L’organisation assure qu’elle « va voir ce qu’elle peut faire », mais pour l’instant, le jeune homme est dans le flou.
Après la fuite des vidéos, il dénonce à MEE un durcissement de la détention : « Il y a beaucoup de tensions. On a commencé à nous enfermer [dans les chambres] dès 19 h. À partir de là, nous, on a refusé de prendre le petit-déjeuner. Le colonel est venu nous parler, il était très fâché. Il a menacé de nous jeter en prison, il nous a dit qu’on était dangereux pour la sécurité nationale de la Tunisie. Il y a même eu des menaces de blocage de nos dossiers auprès du HCR. On nous a mis la pression pour qu’on se remette à manger. »
Il déprime : « On est en prison. On n’espère plus rien. On veut notre liberté, on a besoin de sécurité. À n’importe quel moment, tout peut basculer. »
Les migrants sont incités au retour mais doivent le faire par leurs propres moyens, selon Rajabu Kilamuna. « C’est incompréhensible. Certains ont une femme ici, des enfants. Ils ont leur maison, ils travaillent, c’est leur deuxième pays. On les attrape comme ça, on les met à El Ouardia, on leur dit de payer leur billet et de rentrer chez eux. »
Insalubrité
Au début du mois de mars, le téléphone vissé à l’oreille, Rajabu Kilamuna a décrit à MEE les conditions de vie spartiates à El Ouardia : « Il y a des chambres avec quatre lits, d’autres avec huit, voire plus parfois. »
Il n’y a pas assez de douches pour tout le monde, l’une des cabines n’a pas de porte. « On a mis un pagne pour couvrir. » Vingt-six migrants vivent alors dans le centre, dont cinq mineurs.
Une partie du bâtiment est réservée aux femmes, qui ne sont jamais très nombreuses, moins d’une dizaine.
Le 10 avril, Rajabu Kilamuna partage le message enregistré par l’une d’elles : « On dort sur des couvertures qui ne sont pas vraiment propres. On a des démangeaisons partout. Quand on leur demande des serviettes hygiéniques, c’est tout un problème. On [vit] dans des conditions calamiteuses. Ça fait combien de temps qu’on ne se lave pas ? Il n’y a pas de chauffage ici, il fait très froid. On est toutes malades. »
Elle conclut : « Franchement, moi je ne sais pas ce qui se passe ici. Nous, on est fatiguées d’être enfermées ici. Si nous ne sommes pas des prisonnières, que sommes-nous ? »
Chez les hommes aussi, il y a un manque criant d’hygiène : « On garde les mêmes habits depuis des semaines [depuis leur arrestation] », précise Rajabu Kilamuna. « Certains n’ont pas de savon, ni de shampooing, on se lave à l’eau. »
Le jour suivant cet échange, les autorités acceptent de distribuer quelques produits. « Voilà, après deux semaines et après avoir réclamé hier, on vient juste de nous donner ça », résume-t-il avec ironie, en envoyant une photo de ce maigre butin.
Le centre dispose d’une petite cour où les détenus jouent au foot. Dans la salle à manger, il est possible de regarder la télé, la seule véritable distraction qui permet de faire passer un peu le temps.
« Mais il n’y a pas assez de chaises pour tout le monde. » Il n’y a que quelques prises électriques pour recharger les portables. « Chaque matin, c’est la course. Premier arrivé, premier servi. Parfois, ça crée des problèmes entre migrants », poursuit-il. « Il y a des insultes, des bagarres parfois. »
Le top départ est donné à 6 h, lorsque « les gardes » viennent ouvrir les portes des chambres qu’ils barricadent le soir. « La porte est bloquée par une barre de fer et un cadenas. »
En général, c’est à 21 h que l’on prévient les prisonniers qu’il est l’heure d’aller au lit. « On éteint et on rallume les lumières pour dire aux détenus qu’ils doivent aller dans leur chambre. » Mais ça dépend de « l’humeur de la personne », lâche Rajabu Kilamuna. Les portes peuvent se fermer beaucoup plus tôt, dit-il.
Quand la Tunisie décrète en mars le confinement général afin de ralentir la propagation du COVID-19, l’inquiétude monte au centre d’El Ouardia. Dans l’un de ses messages, le 5 avril, Rajabu Kilamuna annonce que les détenus vont se mettre en grève de la faim. Il dénonce l’insuffisance des mesures sanitaires face au risque de contamination.
« Ça fait longtemps qu’on n’a pas parlé. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. C’est pour vous signaler que demain on va commencer la grève générale, totale parce que la situation ne change pas. On nous amène tous les jours des gens. On a peur que si le virus se faufile parmi les prisonniers, ce soit la catastrophe. »
Le FTDES exige alors « la libération de tous les migrants détenus à El Ouardia ». C’est une demande de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’échelle planétaire, en ces temps de pandémie, fait valoir l’ONG.
Dans des conditions d’insalubrité et de promiscuité, une épidémie de COVID-19 aurait des conséquences mortelles.
« On n’a pas malheureusement de réponse, on a juste des promesses [des autorités] pour étudier la situation », rapporte dans un message audio le chargé de communication du FTDES, Romdhane Ben Amor.
Quinze jours plus tard, les détenus cessent leur mouvement de protestation. Ils ont seulement obtenu le droit de ne plus être enfermés dans les chambres la nuit. Une petite victoire qui en prépare une bien plus importante. Historique même.
Bras de fer judiciaire
Le 5 juin, avec l’aide d’un groupe d’avocats, 22 migrants saisissent le tribunal administratif de Tunis et exigent leur libération. Ils sont soutenus par l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), Avocats sans frontières et Terre d’asile Tunisie. Mais aussi le FTDES, qui est formel : El Ouardia n’a pas été conçu pour héberger, temporairement, des migrants, comme le laisse supposer sa dénomination officielle.
L’ONG écrit : « En l’absence de texte de loi permettant la détention, étant donnée l’interdiction de sortir du centre sans ordre judiciaire, la véritable fonction du centre d’accueil et d’orientation est en réalité la détention. »
Maître Alaa Khemiri argumente : « Le problème, c’est qu’El Ouardia n’a aucune qualification juridique et qu’il n’est pas reconnu par l’État. » Il n’y a aucun cadre légal.
« Dans ce centre, on n’applique pas la loi tunisienne, les garanties de l’accusé et son droit d’être assisté par un avocat. La détention ne doit pas excéder 48 heures et l’affaire doit ensuite être examinée par le procureur, qui peut délivrer un mandat de dépôt. Mais on n’a pas tout ça. »
À El Ouardia, dit-il, se pratique la détention administrative, quelque chose qui « n’existe pas dans la législation tunisienne ».
Les organisations internationales, comme le HCR, sont au courant du problème. Terre d’asile-Tunisie apporte une assistance aux détenus, une aide juridique, sociale, donne des kits d’hygiène aussi, mais elle ne travaille pas avec le centre de détention, se défend sa directrice, Sherifa Riahi.
Elle évoque pour MEE les difficultés légales, le statut du camp qui empêche son association d’accéder en bonne et due forme aux bâtiments. « Même quand on y va, on n’a pas de papiers officiels », confie-t-elle.
Son de cloche identique du côté de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui « ne fait pas de visites régulières », affirme Paola Pace, chargée d’affaires en Tunisie. « C’est à la demande des autorités » que l’organisation onusienne intervient, pour aider « des personnes vulnérables, pour, parfois, faire libérer des femmes en difficulté, des mineurs ».
L’OIM assure tout faire pour mettre fin à la détention des migrants. « Il y a des alternatives. C’est notre devoir de travailler avec nos États membres, pour identifier les possibilités. En Tunisie, il y a des centres ouverts gérés par le HCR ou l’OIM, où les gens ne sont pas privés de leur liberté et on travaille très bien avec les autorités dans ce sens. »
Pour maître Alaa Khemiri, le constat est cinglant : « Il y a deux systèmes carcéraux en Tunisie. Un système parallèle est réservé aux migrants et aux réfugiés, toute personne qui n’a pas la nationalité ou la résidence tunisienne. »
Le 9 juillet, la décision du tribunal administratif tombe : les 22 migrants doivent être libérés. Leurs droits fondamentaux ont été bafoués, estime la juridiction.
Épilogue
« Une joie », « de la satisfaction », malgré la portée de l’événement, la voix reste posée. « Je suis content comme tout le monde, mais avec des réserves parce qu’on attend encore l’exécution de la décision », tempère Rajabu Kilamuna, dans un message audio le 19 juillet.
« Les choses sont encore floues. » Comme d’habitude, l’administration du centre ne communique pas, soupire-t-il. Il a désormais du mal à mesurer le temps passé au centre. Il s’y reprend à deux fois : « Ça fait cinq mois et cinq jours précisément que je suis en détention à El Ouardia. »
Parmi les 22 concernés par la décision du tribunal administratif, les derniers sont sortis le 23 septembre. La libération de Rajabu Kilamuna, elle, n’a pas encore eu lieu. Après sept mois passés à El Ouardia, il attend toujours.
Entre les murs du centre presque désert, il a un unique compagnon d’infortune : « Un Marocain. C’est un ancien. Il a été arrêté pour avoir violé le confinement. Il a déjà fait El Ouardia deux fois. Il a aussi été interné à l’hôpital psychiatrique Razi, à Tunis, deux fois. Il a des problèmes mentaux. »
Leur présence atteste du maintien de l’activité à El Ouardia. « Le placement des migrants au centre de détention illégal d’El Ouardia, ce n’est pas encore fini. A LUTA CONTINUA [La lutte continue, slogan de ralliement du Front de libération du Mozambique pendant la guerre d’indépendance] », écrit Rajabu Kilamuna dans un dernier message le 30 septembre, en postant cette photo :

Rajabu Kilamuna pose avec son unique codétenu à El Ouardia le 30 septembre (photo prise par Rajabu Kilamuna)
Par Fatima-Ezzahra Bendami, publié sur Middle East Eye le 8 octobre 2020.
Photo: Les chambres du centre d’El Ouardia (photo prise par les détenus en mars 2020)